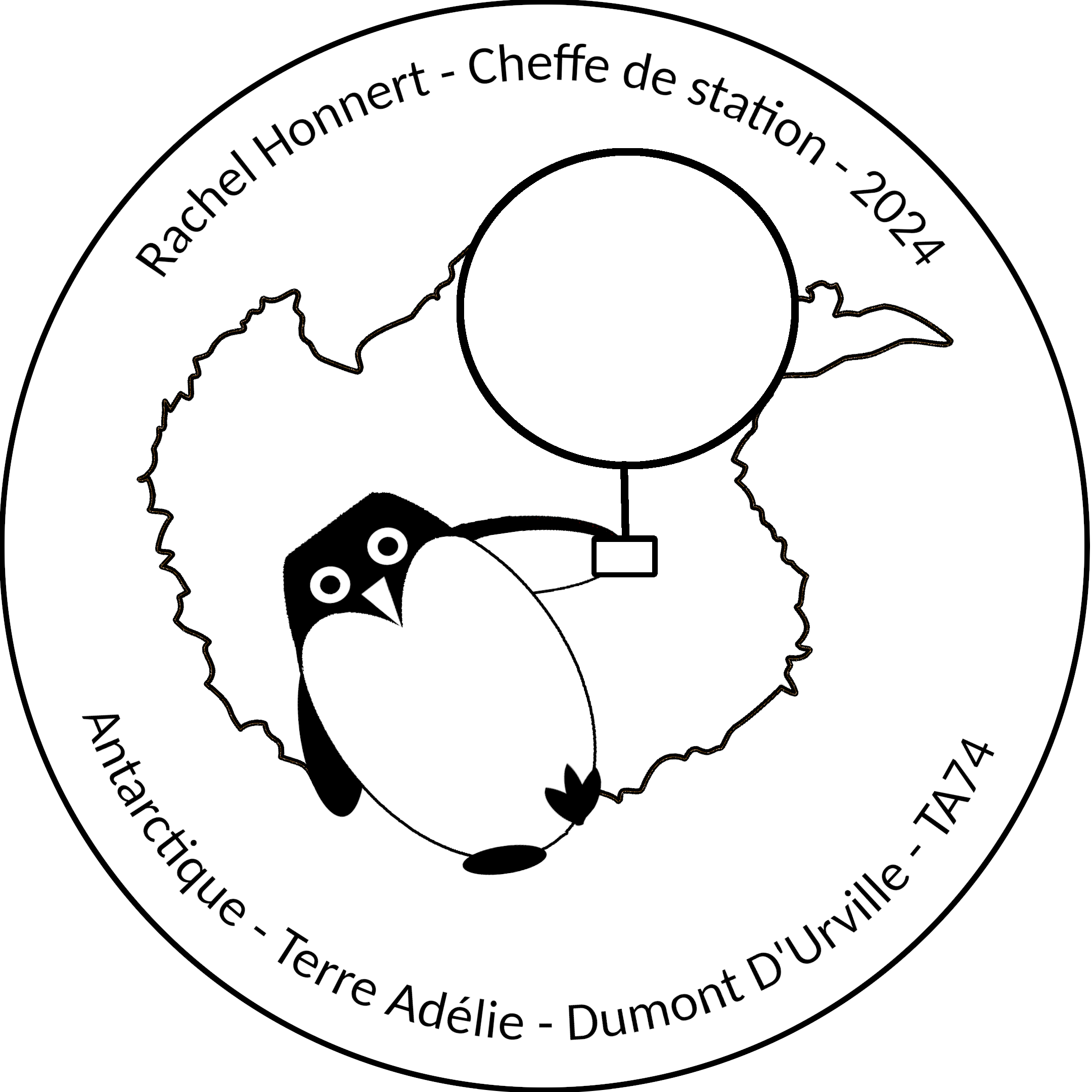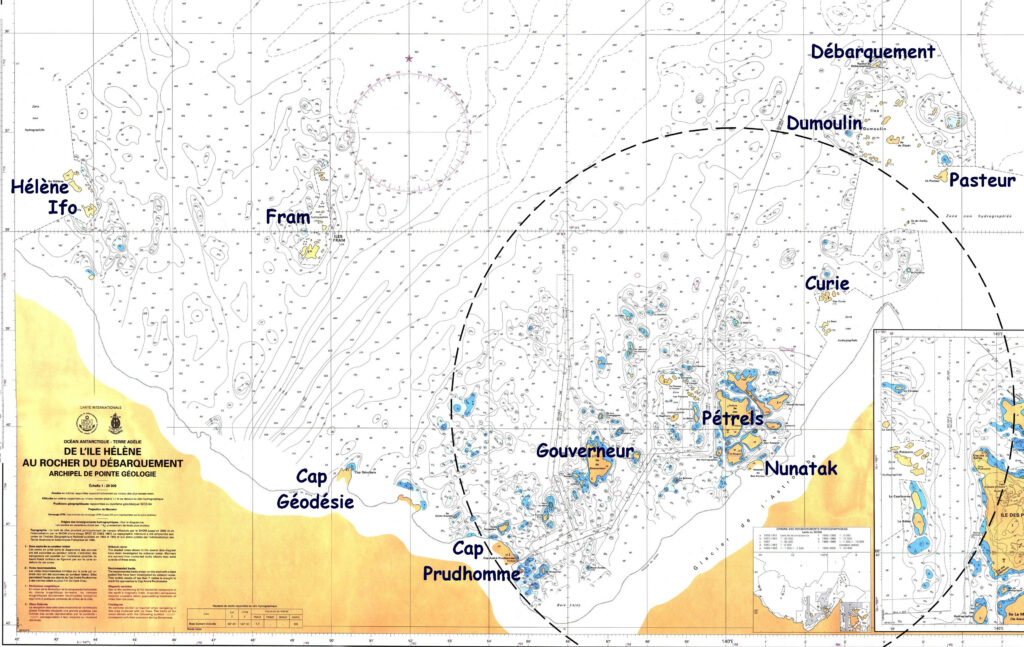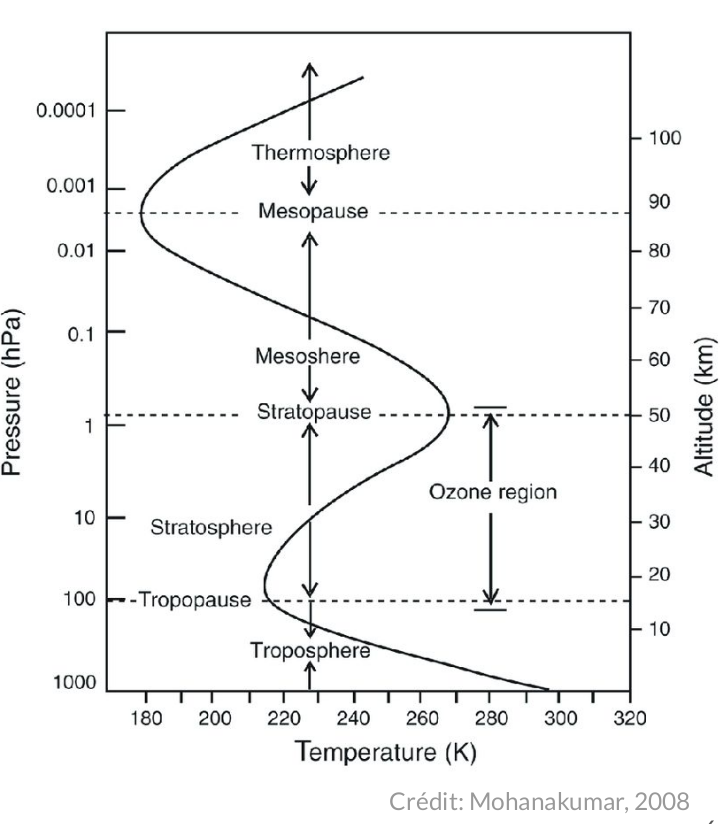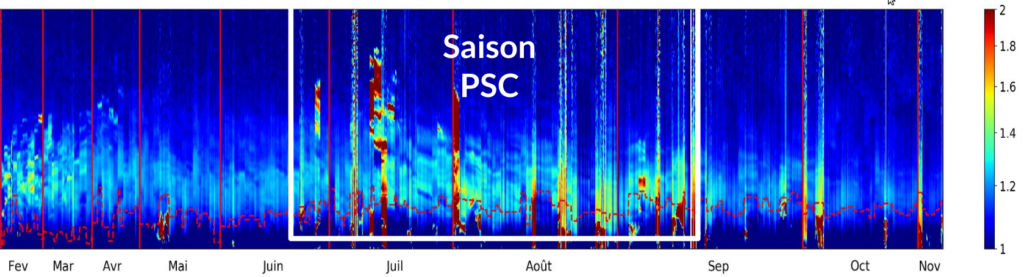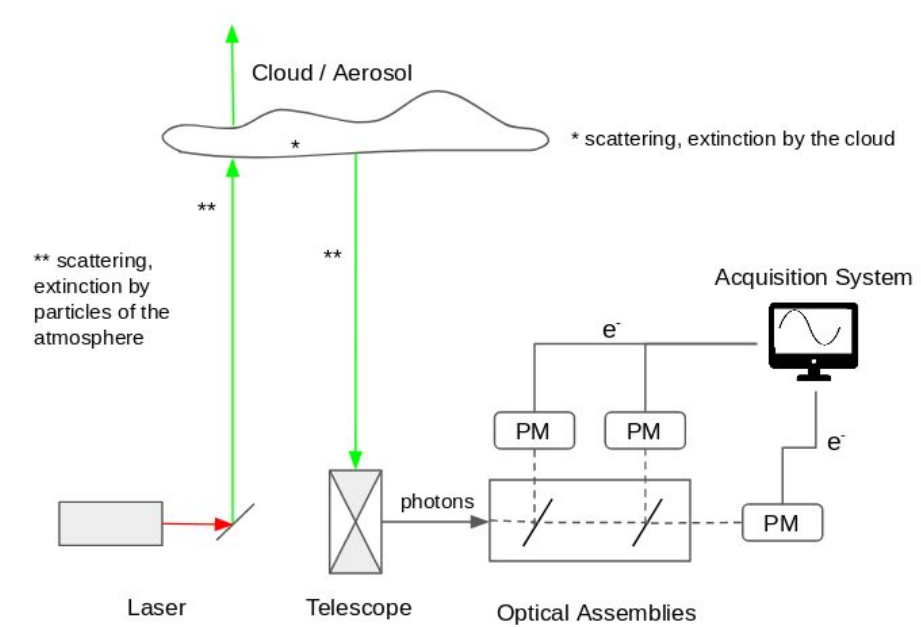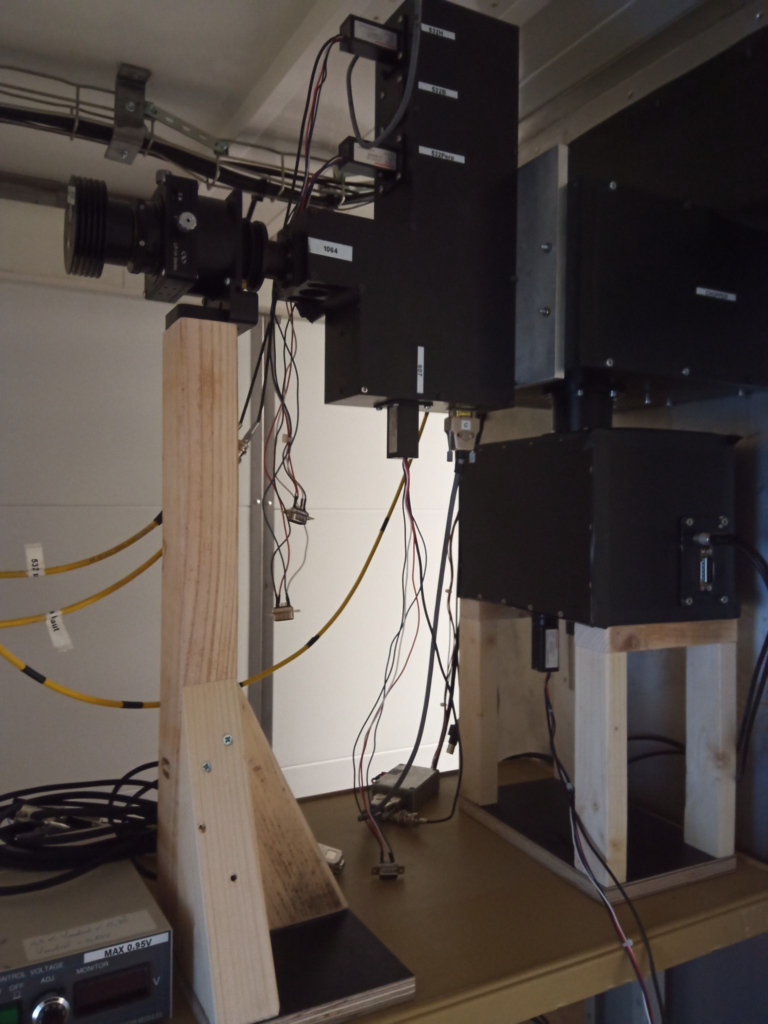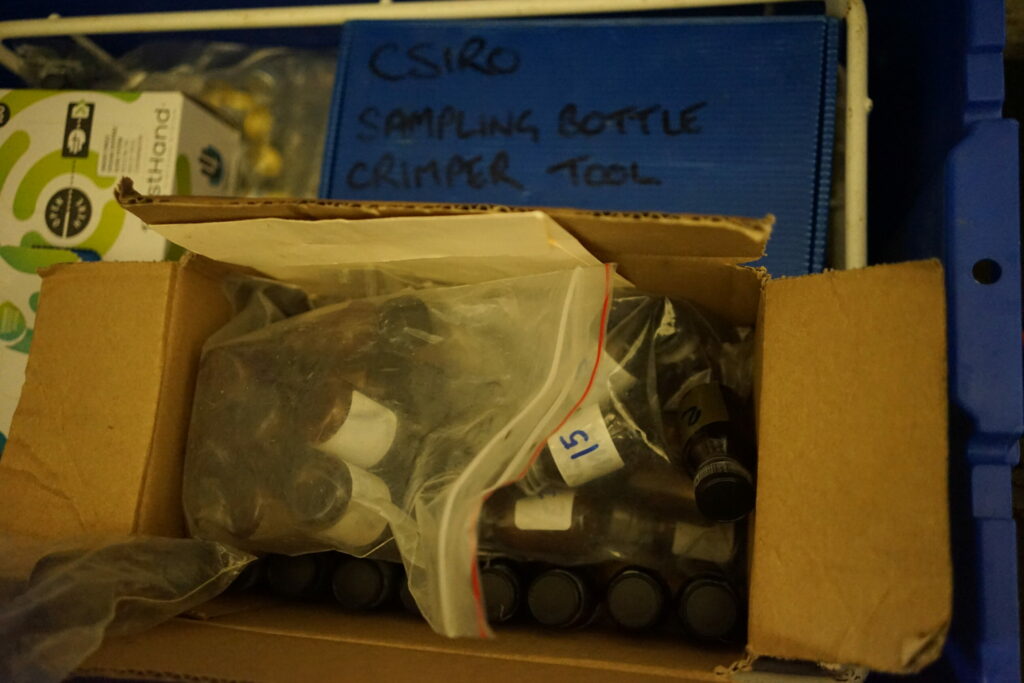C’est la dernière activité des hivernants. Celle que tout le monde veut faire. Les hivernants sortants (dont je fais partie) sont ultra-prioritaires. Mais entre les veilles météo, le mauvais temps, et les repos des ornithos… je n’ai pas pu y aller avant l’avant-dernier jour de manip’.
Je suis donc partie le 2 décembre, avec des néophytes : Lise, Narcisse (nouvelle boulangère) et Alex (pilote d’hélicoptère) et des experts : Doumé (spécialiste des transpondeurs), Léo (ornithologue campagnard), Natacha et Amandine (la nouvelle ornithologue hivernante) pour les professionnels. Nous sommes partis avec deux pulkas de matériel (le nécessaire pour les parcs était déjà sur place). Il faisait un temps magnifique.

Les poussins des manchots Empereurs sont grands maintenant. Je les ai vu sortir de l’œuf, grandir, se faire attaquer par les skuas et les pétrels géants. Mais ça fait bien deux mois que je ne suis pas allée au Nunatak. La manchotière s’est beaucoup étalée. Les poussins mesurent 80cm et pèsent quelques 15kg. Ils se rassemblent en crèches et sont gardés par les quelques adultes qui restent quand les autres sont déjà repartis en mer pour se nourrir.

A l’aide de quatre barrières très légères, on parque les poussins sans les adultes. On place une tablette en bois sur le parc pour les opérations de capture. On forme deux chaines de traitement.

Un ornithologue entre dans le parc et capture un poussin. Il le place sur la tablette et lui attrape le bec. De l’autre côté de la barrière, nous (les néophytes) passons sur la tête du poussin une chaussette qui lui cache les yeux, mais ne couvre pas le bec. L’ornithologue place le poussin dos à nous. Nous le prenons en mettant les bras sous les ailerons et le soulevons. Quand on a de la chance, il se débat jusqu’à ce qu’il ait les pattes en l’air. Sinon, quand on n’a pas de chance, il se débat tout le temps.

Comme le bec et les griffes des manchots sont libres de nous blesser, on porte les vareuses oranges (bien solides), des gants de travail (qui nous embêtent et qu’on enlève) et notre masque pour se protéger les yeux.

Les ailerons des manchots leur servent à se propulser dans l’eau quand ils nagent et chassent. Ils sont très fins, plats et forts. Nous maintenons les poussins sous les ailes pour éviter qu’ils ne se déboitent l’épaule en se débattant. Le corollaire est qu’ils battent des ailerons en se débattant et frappent nos avant-bras. C’est comme si on était frappé par un instrument en bois. Un plaisir …

Une fois qu’on a un manchot dans les bras (et qu’il est calme), c’est mignon, doux et ça ne sent pas mauvais comme les manchots Adélie. Nous les apportons à une équipe d’ornithos. Léo (ou Doumé) prend le manchots par le torse, pendant que nous le tenons par les pieds. Le poussin bascule sur le ventre et Léo se met dessus. Il retire le duvet entre la queue et une patte. Passe le lecture de transpondage pour vérifier que l’oiseau n’est pas encore transpondé. Il désinfecte et utilise un genre de pistolet pour injecter une puce sous la peau de l’animal (comme les phoques). Le manchot ne sent rien à cet endroit et ne bouge pas du tout. Pendant ce temps, Amandine (ou Natacha) mesure le bec de l’oiseau avec un pied à coulisse.

On reprend le poussin sur les genoux. Amandine lui mesure les ailes, quand Léo lui prélève quelques plumes au niveau du torse et tâte le ventre du manchot pour savoir si son estomac est plein. Puis Léo maintient l’aile droite quand Amandine désinfecte et fait une prise de sang. Léo met le poussin dans une capuche et le transporte jusqu’à une potence où on pèse l’animal. On marque l’oiseau au ventre et sur le bout des ailes avec de la peinture verte. Et on le libère. Pendant ce temps, Amandine a désinfecté tous les ustensiles et préparé le transpondeur.
Un de nous (néophytes) écrit dans un carnet l’heure, les mesures (bec, ailes, poids), les numéros de transpondeur, la prise de sang et/ou de plumes, le stade de mue et si le poussin a de la nourriture dans l’estomac. Un autre se repose en veillant à ce que les poussins du parc ne se fassent pas la malle.
On a fait deux parcs. Un contenait de petits poussins gentils. Un autre des adolescents prêts à partir en mer et qui voulaient en découdre. On s’est occupé de 33 poussins en une après-midi. Je comprends pourquoi les ornithologues sont fatigués. J’ai moi-même des bleus sur les bras. Comme toujours avec l’agence de voyage de DDU Biomar Tourisme, dirigée par les ornithologues du bâtiment Biomar de la Dumont d’Urville, on est allé le plus loin de la base qu’on pouvait (1 km) et on avait du gâteau et du chocolat chaud pour le 4h.